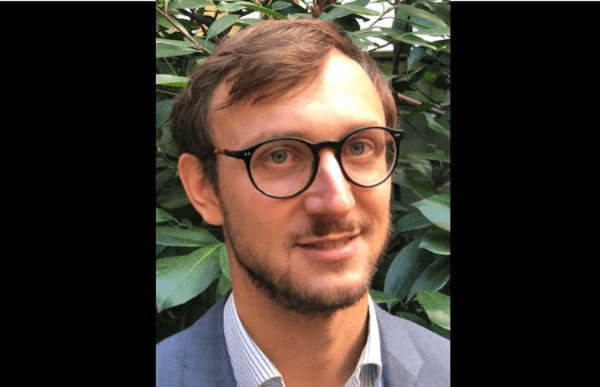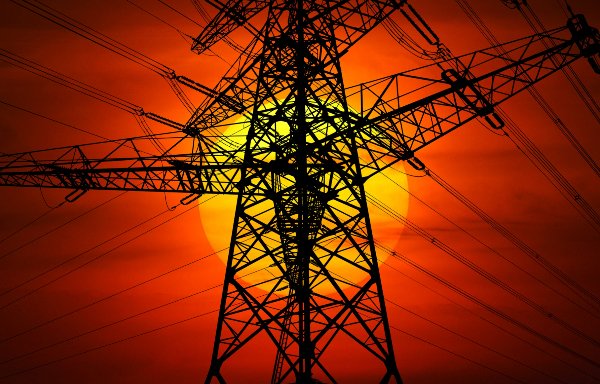Le « Cloud and AI Development Act » constitue l’une des initiatives phares dans le domaine du numérique, pour la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. Cette initiative procède d’une recommandation issue du rapport Draghi publié en septembre 2024 – soulignant notamment l’importance d’accroître les capacités de calcul sur le territoire européen. Car le constat dressé par la Commission européenne est clair : l’UE reste à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine en termes de capacité de datacenters.
Une expertise de Lucas Buthion, Président & Fondateur de Gearshift- Public Affairs
Une intervention publique apparaît ainsi impérieusement nécessaire, selon l’exécutif européen, pour créer des conditions plus propices à l’investissement sur le sol européen – la Commission table sur un triplement des capacités en data centers d’ici cinq à sept ans. Le tout sans rien sacrifier à un double-objectif sous-jacent, de compétitivité et de souveraineté.
La Commission européenne a ouvert au printemps un appel à contributions publiques, clôt le 4 juillet dernier. L’occasion de faire le point sur les arguments mis en avant par les acteurs du datacenter qui se sont prêtés à cet exercice démocratique – à l’instar, pour les opérateurs de datacenters, de l’Association européenne des datacenters (EUDCA), France Datacenter, son homologue italienne (IDA), Equinix, AtlasEdge datacenters ou EdgeConnex.
Sans surprise, l’accès à l’énergie et aux énergies renouvelables est un premier sujet récurrent – mis en exergue par EUDCA comme le « plus grand défi » pour l’industrie des datacenters. Selon l’association européenne, « dans un nombre croissant d’endroits, le réseau n’est pas en mesure de fournir l’énergie nécessaire. Lorsqu’il est disponible, il y a souvent un décalage entre le temps de développement du centre de données (entre 5 et 36 mois) et l’accès au réseau de transmission (7 à 8 ans) ». Equinix ne dit pas autre chose : « giga-factories need gigawatts », déplorant que beaucoup de métropoles européennes manquent de capacité, même pour 100 MW.
Sur un plan macro, c’est véritablement sur l’expansion, la modernisation et la numérisation des infrastructures énergétiques que l’effort devrait porter – et la flexibilité du réseau encouragée, par exemple, via la reconnaissance des datacenters non seulement en tant que consommateurs d’énergie, mais aussi en tant que contributeurs actifs à la stabilité du réseau – par la production sur site, les services de flexibilité et l’investissement conjoint à l’œuvre dans la modernisation du réseau.
Par ailleurs, l’UE devrait jouer un rôle, selon EUDCA, pour fournir des orientations et des incitations cohérentes aux États membres afin que ceux-ci accélèrent et placent en tête des files d’attente des raccordements les projets de datacenters ayant une « importance stratégique » – sans pour autant que cette notion ne soit précisément définie, au-delà des montants d’investissements en jeu.
Autre cheval de bataille unanimement relayé par les industriels pour limiter le risque de fragmentation du marché intérieur et les surcoûts induits : faciliter, rationaliser, accélérer les procédures d’autorisation en Europe, aux niveaux national et local – notamment en créant des « guichets uniques nationaux » pour l’octroi des autorisations, en appliquant des définitions harmonisées établies au niveau de l’UE et une interprétation cohérente des règles relatives aux permis.
Concrètement, EUDCA propose trois mécanismes d’approbation accélérée :
- les projets qui se situeraient au plus haut des standards environnementaux et d’efficacité énergétique – grâce à un label basé sur la Directive efficacité énergétique – pourraient bénéficier d’une présomption de conformité aux procédures environnementales ;
- En cas de projets « d’intérêt critique » ensuite – la notion de « criticité » ouvrant à elle seule une boite de Pandore ;
- EUDCA défend enfin l’idée d’un « premium » dont les opérateurs de datacenters pourraient s’acquitter pour accélérer leurs demandes de permis.
Sur le plan environnemental, EUDCA reste alignée sur les objectifs fixés par le Climate Neutral Data Centre Pact – bien que ses objectifs aient été établis en 2021, avant l’accélération de la « hype » autour de l’IA. Avant d’introduire des mesures supplémentaires liées à l’efficacité énergétique, il conviendrait en premier lieu, selon le collectif industriel, de remédier « aux graves lacunes du système de notification » de la directive sur l’efficacité énergétique (EED). Sans cela, l’introduction de nouvelles normes environnementales pourrait se révéler prématurée et « risquerait de compromettre l’effet escompté ». Sans compter que la transposition manifestement hétérogène de cette directive, en fonction des Etats membres, a conduit, selon les industriels à des incohérences en termes de collecte de données – rendant celle-ci peu fiable ou consolidable à l’échelle européenne.
EUDCA estime que s’il y avait lieu d’élargir le champ d’application de l’EED, ce devrait être pour inciter les exploitants peu performants –dont la puissance informatique installée est inférieure à 500 kW – à adopter des pratiques plus durables. L’INRIA, de son côté, estimerait « souhaitable » de « fournir un soutien financier et/ou des opportunités de marchés publics aux acteurs européens qui déploient des technologies (…) différenciatrices » pour les datacenters, comprenant autant les logiciels, les composants et les systèmes, « par exemple lorsqu’ils permettent une efficacité énergétique élevée et optimisent la maintenance opérationnelle ».
Sur la consommation d’eau spécifiquement, EUDCA s’en tient à sa ligne : les volumes imputables aux datacenters sont relativement faibles par rapport à d’autres secteurs, même si la consommation peut effectivement être concentrée localement. Aussi, pour « alléger la pression sur les réserves d’eau locales tout en encourageant les pratiques durables », les acteurs du datacenter recommandent aux régulateurs européens de faciliter l’utilisation des eaux grises industrielles à des fins de refroidissement dans les datacenters, de poursuivre la (coûteuse) modernisation des infrastructures hydrauliques et de créer des incitations ciblées pour encourager l’utilisation d’eau non potable à des fins de refroidissement : autant de préconisations qui paraissent alignées avec l’ambition de la Stratégie européenne pour la résilience de l’eau, présentée début juin par la Commission européenne. L’IDA, elle, met en garde sur un autre plan : attention à ne pas imposer une approche unique, qui ne prendrait pas en compte la diversité des réalités hydriques locales.
Dernier gros pan de revendications de la part des principaux acteurs du datacenter : le recours à des incitations financières pour permettre des implantations dans des régions sous-représentées, moderniser les installations plus anciennes, encourager l’adoption de technologies propres (e.g refroidissement par immersion), ou mettre en œuvre la réutilisation de chaleur fatale dès la phase de conception de nouvelles installations.
Autre levier que le secteur souhaiterait mobiliser, pour autoriser le déblocage de cofinancements renforcés à l’échelon national : obtenir des dérogations aux sacro-saintes règles européennes en matière d’aide d’Etat, via la création d’un PIIEC (projets importants d’intérêt européen commun) – cadre déjà déployé par exemple dans le domaine du cloud, de la microélectronique, des batteries ou de l’hydrogène.
A noter enfin que c’est probablement la toute première fois que l’enjeu de l’acceptabilité est remonté aussi explicitement auprès des autorités européennes. Google Cloud ou l’IDA ont en effet mis l’accent sur le phénomène bien connu du « NIMBY » (not in my backyard). Le rôle crucial – pour ne pas dire la responsabilité – des autorités publiques à l’égard des communautés locales, pour expliquer la plus-value et l’impact socio-économique des datacenters, sont désormais mis sur la table.
La balle est maintenant dans le camp de la Commission européenne – qui va continuer à plancher pour publier sa proposition de « Cloud & AI development Act » a priori au dernier trimestre 2025. Les deux colégislateurs européens, le Conseil de l’UE (= les 27 Etats membres) et le Parlement européen, se pencheront par la suite sur ce texte. Ce qui promet des débats passionnés, tant les spécificités nationales et la diversité des appartenances partisanes conduisent à des approches différentiées, pour ne pas dire parfois antagonistes, sur les problématiques de politiques publiques en lien avec les datacenters et le cloud.