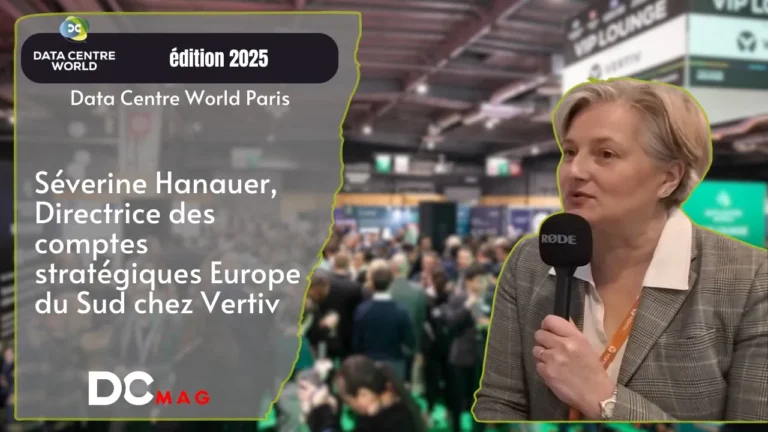L’IA va se développer. Et c’est le report à grande échelle qui définit son empreinte environnementale. Le choix qui s’offre à nous est de déterminer si son impact évoluera à la même vitesse. Grâce à des infrastructures plus intelligentes, cela n’est pas une fatalité.
Expert : Jeff Wittich, Chief Product Officer chez Ampere
A mesure que l’IA générative s’inscrit dans notre quotidien, une nouvelle ère s’ouvre à nous en termes de capacité et de consommation. Ce qui relevait autrefois de la théorie est désormais mesurable jusqu’aux plus petites unités. Des rapports récents de Mistral AI et Google montrent que l’impact environnemental d’une seule interaction via un prompt est minime – l’équivalent d’une fraction de watt, de quelques gouttes d’eau ou de très faibles émissions de gaz à effet de serre, comparables à moins d’une minute de vidéo en streaming.
Considérés isolément, ces chiffres semblent négligeables. Pourtant, leur multiplication à grande échelle change radicalement la donne. Si l’on considère des millions de prompts générés chaque jour dans des milliers de datacenters à travers le monde, l’impact global ne se mesure plus en gouttes ou watts, mais en milliards de mètres cubes d’eau et en gigawattheures d’électricité. Selon les prévisions de l’industrie, la demande mondiale en IA pourrait nécessiter plus de 6,6 milliards de mètres cubes d’eau par an d’ici 2027.
C’est là tout le problème : la production de masse donne aux choses les plus infimes des conséquences majeures. La différence entre un impact environnemental maîtrisé et un impact non viable ne se joue pas sur des décimales, mais sur la manière dont cette montée en puissance est encadrée.
L’industrie doit agir, dès maintenant.
Exploiter à grande échelle mais avec les ressources existantes
Tout rack déjà installé dans un datacenter représente une opportunité de modifier le cours des choses. Avec des processeurs adaptés, des charges de travail optimisées et une orchestration plus intelligente, il est possible d’augmenter considérablement la puissance délivrée par rack, sans accroître proportionnellement la consommation en eau et en électricité. Le déploiement massif de l’IA est peut-être inévitable, mais ses conséquences ne le sont pas.
Accompagner la croissance sans multiplier les contraintes
De nouveaux datacenters verront le jour, et ils seront indispensables. Toutefois, en optimisant les infrastructures existantes, on peut ralentir les besoins croissants en infrastructures. Cela permet de faire en sorte que les nouvelles constructions soient des expansions stratégiques, et non des solutions provisoires et non durables. La consommation énergétique des centres de données de nouvelle génération peut être significativement réduite si l’on exploite mieux ce qui est déjà en place.
Évoluer avec responsabilité
Les statistiques par prompt sont utiles car elles nous donnent une certaine visibilité, mais le réel moyen de mesurer notre engagement réside dans la gestion exponentielle de ces chiffres. Même si l’on continue d’innover, la réduction de l’empreinte environnementale de l’IA dépend de l’efficacité au niveau des racks et des systèmes (processeurs, refroidissement, orchestration). À grande échelle, même de petites améliorations peuvent entraîner des réductions significatives de la consommation d’eau et d’énergie.
L’IA va se développer. Et c’est le report à grande échelle qui définit son empreinte environnementale. Le choix qui s’offre à nous est de déterminer si son impact évoluera à la même vitesse. Grâce à des infrastructures plus intelligentes, cela n’est pas une fatalité.