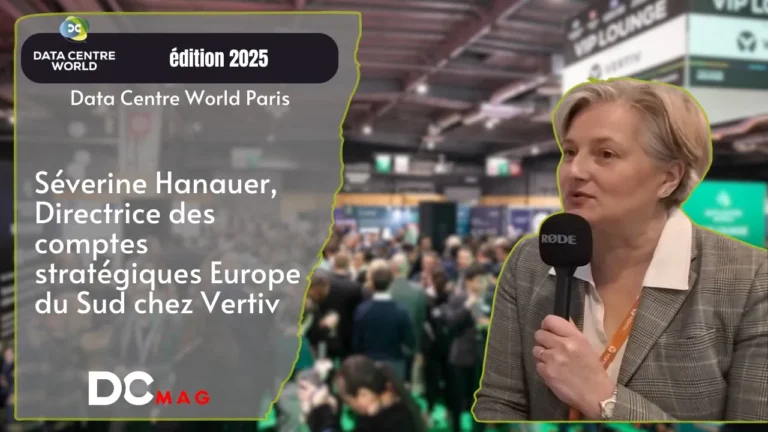Le 18 novembre 2024, la Commission européenne a mené des opérations de visites et de saisies dans les locaux de plusieurs entreprises actives dans la construction de data centers (voir le communiqué de presse de la Commission). Elle soupçonne notamment une entente sous la forme d’accords de non-débauchage.
Auteurs : Natasha Tardif, associée, Lucile Chneiweiss, conseil, Alexandre Shamloo, collaborateur, du cabinet Reed Smith
Points clés à retenir
- Les entreprises des secteurs de la tech et de l’informatique font face à une nouvelle vague de contrôle de conformité concernant leurs pratiques en matière de ressources humaines.
- Les responsables des ressources humaines doivent être formés sur les sujets de conformité, y compris en matière de droit de la concurrence.
- Les opérateurs de data centers doivent réexaminer leurs politiques de recrutement, leurs contrats de travail ainsi que les clauses contractuelles liant leurs partenaires.
- Les pratiques de recrutement doivent être intégrées à la due diligence des opérations de fusions-acquisitions.
Qu’est-ce qu’un accord de non-débauchage ?
Les accords de non-débauchage visent, pour les employeurs, à s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif. Avec ces accords, les entreprises acceptent de ne pas embaucher ou solliciter les salariés, actuels ou potentiels, de leur cocontractant, tels que détaillés par la Commission dans sa note d’information de mai 2024. Ces accords peuvent tant concerner un secteur entier que seulement quelques parties et peuvent être réciproques ou unilatéraux.
La Commission européenne considère les accords de non-débauchage comme des ententes anticoncurrentielles ou des restrictions horizontales par objet au sens de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. Autrement dit, ils sont considérés comme suffisamment nuisibles à la concurrence pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en analyser les effets sur le marché concerné.
Selon la note d’information, dans cette affaire, les participants à l’entente se seraient concertés sur la source d’approvisionnement, à savoir les employés.
Les entreprises qui se font concurrence pour recruter ou retenir des employés possédant les mêmes compétences sont en concurrence sur le marché de l’emploi, qu’elles produisent ou non les mêmes biens ou services. Par conséquent, indépendamment de leur secteur d’activité, elles ne doivent pas conclure d’accords de non-débauchage.
Renforcement de la répression par les autorités de concurrence
Plusieurs autorités nationales de la concurrence ont déjà appliqué des interdictions d’accords de non-débauchage dans divers secteurs. On peut citer, par exemple, le Portugal dans les domaines du sport et du conseil technologique, la Turquie dans le secteur de la santé (affaire du cartel des hôpitaux privés, décision 22-10/152-62 du 22 février 2022) ou encore la France dans le secteur de revêtements de sol.
L’Autorité française de la concurrence (ADLC) a, le 11 juin 2025, infligé des amendes totalisant 29,5 millions d’euros à quatre entreprises actives dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil technologique et des services informatiques, pour avoir conclu des accords de non-débauchage anticoncurrentiels (voir communiqué). Il s’agit de la première décision de fond de l’ADLC portant exclusivement sur ce type de pratiques. L’Autorité de la concurrence a estimé que ces accords, informels, non écrits et à durée indéterminée, constituaient des restrictions de concurrence par objet. En revanche, elle a écarté les griefs liés à certaines clauses de non-sollicitation insérées dans des accords de partenariat, visant des catégories précises de personnel ou de projets. L’Autorité de la concurrence a jugé ces dernières limitées dans leur portée et leur durée, et, ainsi, qu’elles n’étaient pas intrinsèquement anticoncurrentielles. Elle a toutefois précisé que de telles clauses pourraient être jugées anticoncurrentielles dans d’autres contextes, au regard des circonstances.
L’ADLC avait déjà sanctionné un accord de non-débauchage dans le cadre d’une décision plus large concernant un cartel dans le secteur des produits préfabriqués en béton (voir communiqué). Dans ce dossier, l’Autorité de la concurrence avait estimé que ces accords avaient contribué à une coordination globale entre deux membres du cartel sur l’ensemble des aspects de leur activité économique, ce qui constituait une pratique anticoncurrentielle.
Le 2 juin 2025, la Commission européenne a également sanctionné deux plateformes de livraison de repas à hauteur de 329 millions d’euros pour des pratiques de cartel, comprenant notamment un accord de non-embauche réciproque, suivi d’un accord général de non-sollicitation des salariés respectifs. Selon la Commission, ces pratiques ont restreint la concurrence et réduit les opportunités d’emploi pour les salariés (voir communiqué).
Surveillance accrue des politiques de recrutement des géants de la tech
Le secteur de la tech est particulièrement exposé à l’intensification du contrôle des règles de droit de la concurrence en matière de pratiques de recrutement. Les salariés hautement qualifiés, dotés de formations pointues et de compétences recherchées, comme les ingénieurs logiciels ou les développeurs, représentent un avantage concurrentiel majeur pour les entreprises.
Au-delà des interdictions d’accords de non-débauchage, les autorités s’intéressent désormais aux opérations dites d’« acqui-hire », dans lesquelles une entreprise rachète une start-up essentiellement pour acquérir les savoir-faire ou l’expertise de ses équipes.
De telles opérations peuvent être soumises au contrôle des concentrations. L’Autorité britannique de la concurrence (CMA) et le Bundeskartellamt allemand (BDK) ont tous deux déjà pris position en ce sens.
Selon la CMA, l’équipe en charge du développement constitue « le cœur de toute entreprise cherchant à concevoir des modèles fondamentaux (FMs) ou des chatbots » (voir résumé). Dans ce contexte, l’autorité a estimé que l’acquisition d’une équipe disposant d’un savoir-faire pertinent, même en l’absence d’autres actifs, pouvait relever de sa compétence en matière de contrôle des concentrations.
En Allemagne, l’opération n’a finalement pas été considérée comme notifiable, car la société cible n’exerçait pas d’activité substantielle sur le territoire national au moment de l’acquisition.
Au Royaume-Uni, la CMA a autorisé l’opération, estimant qu’elle ne provoquait pas une réduction significative de la concurrence.