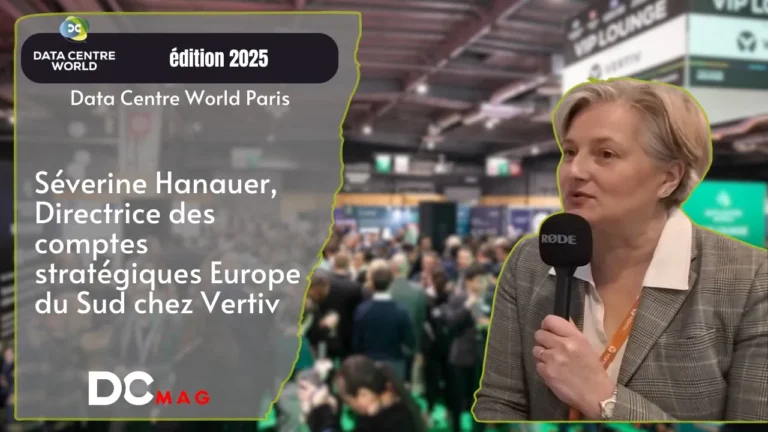Le développement exponentiel de l’usage de l’intelligence artificielle (IA) attire les investisseurs vers les data centers. Mais transformer ces « boîtes » remplies de serveurs avides de mégawatts en flux de trésorerie fiables suppose de maîtriser un nouvel équilibre entre immobilier, infrastructure et risques réglementaires.
Auteur : Carole Steimlé, Associée du cabinet Reed Smith
Pourquoi cet engouement ?
Le trafic mondial de données double environ tous les deux ans, et les seuls clusters d’entraînement à l’IA devraient ajouter près d’un gigawatt de demande supplémentaire sur le réseau électrique français d’ici la fin de la décennie. Résultat : un pipeline de développement qui, autrefois marginal, est désormais au cœur des priorités. Hyperscalers (opérateurs de cloud et data centers), fonds souverains et gestionnaires d’infrastructures ont déjà promis des dizaines de milliards d’euros pour des campus en France, tandis qu’une nouvelle législation propose un traitement accéléré pour les « projets d’intérêt national ».
En clair, cette classe d’actifs devient aussi stratégique que les aéroports ou les autoroutes, tout en s’échangeant à des taux de rendement dignes de l’immobilier logistique prime.
Un rendement digne des infrastructures, la croissance en plus
La thèse d’investissement repose sur trois piliers :
- Des baux exceptionnellement longs : les contrats de colocation hyperscale s’étendent souvent sur 10 à 15 ans, avec des hausses progressives de loyer et la répercussion des coûts.
- Des locataires captifs : les coûts de migration et les contraintes de latence rendent tout déménagement difficile.
- Une demande structurelle : les besoins en cloud, edge computing et IA générative n’ont aujourd’hui aucun substitut crédible.
En combinant ces éléments, ces actifs peuvent générer des revenus proches de ceux des obligations, tout en offrant une croissance plus proche de celle des actions, une combinaison rare dans un environnement marqué par la faiblesse des rendements.
Opportunités d’investissement
- Développement (greenfield)
La rareté des capacités de niveau Tier III / Tier IV permet à certains projets construits sur fonds propres de trouver preneur avant même leur achèvement, notamment autour de Paris, Marseille et dans de nouveaux pôles régionaux adossés à des sources d’énergie renouvelable. Les développeurs qui parviennent à sécuriser le foncier, l’alimentation en haute tension et la fibre noire peuvent espérer des marges de développement supérieures de plus de 250 points de base aux rendements des actifs stabilisés.
- Conversion (brownfield)
Des friches industrielles ou anciens sites bancaires désaffectés sont réhabilités pour accueillir des data centers. Ces opérations permettent souvent de gagner du temps par rapport à une construction neuve, tout en profitant parfois d’un raccordement électrique existant ou d’exonérations fiscales. Ces avantages peuvent toutefois être annulés par les coûts de dépollution ou de mise aux normes structurelles.
- Sale-leasebacks
Les entreprises continuent de céder leurs propres installations pour ré-allouer les capitaux à leurs activités principales. Les acquéreurs obtiennent ainsi des flux de trésorerie dès le premier jour, tout en conservant des options pour augmenter la puissance ou installer des équipements supplémentaires à l’expiration des baux actuels.
Points de vigilance
1 – L’énergie, nouveau locataire-clé
L’accès à des mégawatts à des tarifs compétitifs et bas carbone est désormais une condition sine qua non. Les gestionnaires de réseaux exigent de plus en plus des capacités d’effacement, des productions locales ou des approvisionnements via des contrats PPA indexés sur les énergies renouvelables. Les accords avec les fournisseurs d’électricité adossés au nucléaire offrent un avantage carbone, mais s’accompagnent souvent d’un examen politique renforcé. Les investisseurs doivent soumettre leurs modèles à des stress tests intégrant les risques de délestage, les délais de raccordement et l’indexation tarifaire sur l’inflation.
2 – Risques liés au foncier et au zonage
Le droit de l’urbanisme en France distingue les data centers des entrepôts classiques, ce qui leur permet d’échapper à certaines taxes locales, mais implique aussi des obligations spécifiques :
- Dans la région parisienne, la plupart des projets dépassant 5 000 m² doivent obtenir une autorisation préfectorale fondée sur des critères de zéro artificialisation nette, de performance énergétique et de valorisation de la chaleur fatale (article R. 510-6 du code de l’urbanisme).
- Un projet de loi prévoit d’autoriser les communes à déroger à hauteur de 30 % à la limite d’artificialisation nette pour les projets de data centers, bien que de nombreux amendements visent à en limiter ou en supprimer l’effet.
- Un autre projet de loi visait à autoriser les préfectures à passer outre les documents d’urbanisme locaux et les évaluations environnementales pour les projets reconnus d’« intérêt national », tandis que certains amendements s’opposent à ces dérogations et souhaitent réintroduire un contrôle environnemental renforcé, y compris via un amendement gouvernemental visant à maintenir l’évaluation environnementale obligatoire.
Un dialogue en amont avec les agences régionales et l’intégration de solutions de conception adaptative, telles que les toitures végétalisées ou les réseaux de chaleur urbains, influencent désormais autant les délais d’instruction que les études de circulation dans le secteur logistique.
3 – Enjeux environnementaux et sociaux (ESG)
Les règles de la taxonomie européenne imposent déjà aux exploitants de data centers d’une capacité supérieure à 500 kilowatts de publier chaque année des indicateurs d’énergie et de consommation d’eau. Les investisseurs doivent, à court terme, répondre à trois impératifs :
- Attester d’un chemin crédible vers un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur ou égal à 1,3, avec une couverture en énergies renouvelables de 80 à 100 % ;
- Documenter des contrats de valorisation de la chaleur fatale – en leur absence, les municipalités peuvent exiger des mesures compensatoires ou refuser les autorisations ;
- Se préparer à la pression croissante sur les émissions indirectes (Scope 3), car le carbone incorporé dans les serveurs et les aménagements intérieurs peut dépasser les émissions opérationnelles sur l’ensemble du cycle de vie.
Les actifs sous-performants risquent à la fois des décotes pour obsolescence climatique et un coût de la dette accru, les prêteurs intégrant désormais des clauses ESG dans leurs conditions de financement.
4 – Spécificités fiscales et structuration
Une récente décision du Conseil d’État a confirmé que les salles de serveurs ne sont pas considérées comme des « locaux de stockage », ce qui les exonère de la taxe sur les entrepôts en Île-de-France. En revanche, les bureaux annexes restent taxables et une réforme pourrait à l’avenir réduire cette exonération. Les structures d’investissement de type SPV doivent être conçues pour intégrer une éventuelle requalification fiscale, avec des clauses d’indexation de loyers capables d’absorber l’apparition de nouvelles taxes.
Dans le cadre de cessions-bail (sale-leaseback), les acheteurs doivent également anticiper l’application de la TVA sur les travaux et s’assurer que les contrats prévoient le transfert des taxes sur l’électricité, dont le poids peut rivaliser avec celui de la facture énergétique elle-même.
5 – Risques liés à la construction et aux technologies
Les délais de livraison pour les transformateurs et les groupes électrogènes de secours s’étendent de 12 à 18 mois. Les clauses de pénalités basées uniquement sur l’achèvement pratique des travaux sont souvent insuffisantes. Il est préférable d’aligner les incitations contractuelles sur des jalons progressifs, comme les mises sous tension par tranches. Par ailleurs, les évolutions rapides au niveau des composants (interconnexions optiques, refroidissement par immersion) peuvent rendre les conceptions obsolètes en moins de cinq ans. Des structures modulaires flexibles et des vides en mezzanine permettent de limiter les dépréciations et de phaser les investissements.
6 – Résilience opérationnelle et vigilance contractuelle
Les engagements de disponibilité (par exemple, redondance de niveau Tier III+ ou un maximum de 25 minutes d’indisponibilité par an) créent des passifs potentiels. Les assureurs exigent désormais des preuves de dispositifs de gestion des risques environnementaux critiques et des ratios d’équipes certifiées.
La due diligence lors d’une acquisition doit inclure :
- L’analyse des incidents et de leurs causes sur les trois dernières années ;
- Les procédures d’escalade auprès des fournisseurs pour les pannes de batteries, d’alimentation sans interruption (UPS) ou de systèmes de refroidissement ;
- Les dispositifs de cybersécurité physique (réseaux segmentés, contrôle d’accès biométrique) et la conformité avec les réglementations européennes comme la directive NIS2.
Des garanties sur les vices cachés ou la non-conformité historique permettent de préserver la valeur dans les cas où aucune assurance n’est disponible.
Transformer la complexité en avantage concurrentiel
Les investisseurs les plus aguerris transforment ce dédale réglementaire et technique en barrières à l’entrée qui pérennisent leurs rendements. Les accords de préfinancement intégrant des droits d’expansion permettent de sécuriser l’accès au réseau avant les concurrents. Coupler des surfaces de data centers avec des projets solaires ou de batteries adjacents ouvre des revenus annexes tout en répondant aux exigences ESG des clients corporate. Enfin, les portefeuilles à grande échelle deviennent des supports potentiels de titrisation : mutualiser des baux de longue durée sur plusieurs zones métropolitaines peut aboutir à des produits de dette quasi-infrastructurels, particulièrement attractifs pour les fonds de pension en quête de rendement de long terme.
Conclusion
Les data centers se situent à la croisée de la transformation numérique, de la transition énergétique et de la raréfaction du foncier. S’ils sont bien conçus, leur acquisition ou leur développement peut générer des flux de revenus résilients et une appréciation du capital. La recette est toutefois multidisciplinaire : il faut combiner l’ingénierie des infrastructures, l’expertise immobilière, une due diligence juridique rigoureuse et une stratégie ESG intégrée dès le premier jour. Les investisseurs prêts à naviguer dans cette complexité ne feront pas que surfer sur la vague de la donnée, ils en posséderont les canalisations.
Points clés à retenir
- Portés par l’essor de l’intelligence artificielle, les data centers s’imposent comme l’un des segments d’actifs réels à la croissance la plus rapide.
- Le cadre réglementaire se durcit : permis, raccordements réseau et obligations ESG peuvent ralentir voire bloquer les projets.
- L’emplacement, l’accès à l’énergie et à la fibre restent les principaux moteurs de valeur ; à l’inverse, des erreurs fiscales ou de zonage peuvent anéantir les rendements.
- Une due diligence rigoureuse et des garanties contractuelles bien pensées transforment la complexité en avantage concurrentiel.