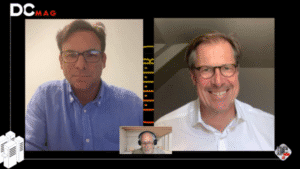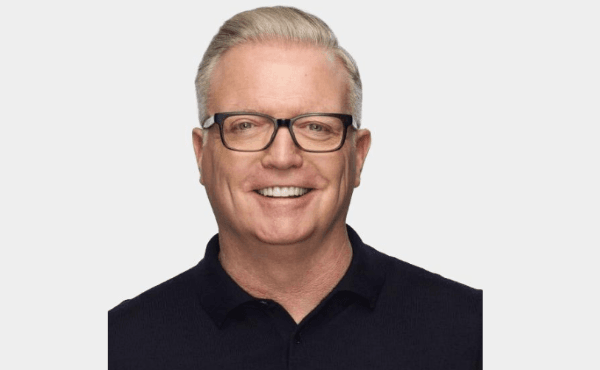Alors que la planète a battu plusieurs records successifs de température cet été et que le réchauffement climatique s’accélère, le secteur des data centers doit relever un défi de taille : celui de l’atteinte de la neutralité carbone.
Expert : Louis-Marie Le Leuch, Directeur Energie et Carbone, Digital Realty en France
Dans un monde où l’augmentation des usages du numérique est synonyme d’extension des besoins de stockage de données, les émissions liées aux data centers comptent pour 16% de l’empreinte carbone du numérique (soit environ 17,6 milliards de tonnes), contre 79% pour les terminaux (ordinateurs, téléphones, etc.) et 5% pour les réseaux télécoms*.
Pour respecter les engagements européens de neutralité carbone à échéance 2050, le secteur doit maîtriser l’ensemble des aspects de son fonctionnement : depuis la construction d’un bâtiment jusqu’à son exploitation, en passant par sa consommation d’énergie, sa maintenance, sa gestion des déchets, et tous ses achats de biens et de services.
La mobilisation de cette chaîne de valeur, dite du scope 3, représente en effet la plus grande partie des émissions du data center, elle est généralement plus élevée que la somme des émissions directes (scope 1) et de la consommation d’énergie (scope 2). Ainsi, les analyses de cycle de vie révèlent que les immobilisations représentent 44% des émissions totales du scope 3 – incluant à la fois l’enveloppe du bâtiment (26%), mais également les équipements qui y sont installés (18%) – les achats de biens et de services représentant quant à eux 38%, l’énergie (amont), 14%, les transports, 3%, et enfin les déchets,1%.
Commencer par réduire l’empreinte liée aux bâtiments
Ainsi, la première étape de réduction des émissions carbone passe donc par la révision des normes de construction des bâtiments. Depuis 2022, la réglementation RE2020 oblige tous les acteurs à effectuer une analyse précise du cycle de vie de leurs bâtiments afin d’en mesurer l’empreinte carbone. Ces analyses doivent servir d’outils d’aide à la décision en orientant les choix vers des solutions bas-carbone, ces dernières devant s’intégrer en tant que nouveaux standards de construction.
A titre d’exemple, selon les informations fournies par les constructeurs de data centers, le béton traditionnel représente environ 30% de l’empreinte carbone de l’enveloppe du bâtiment. Toutefois, en optant pour un béton « bas-carbone » qui utilise des matériaux alternatifs au ciment classique et/ou évite la montée en température du ciment libérant du CO2, il est possible de réduire significativement ces émissions, sans pour autant perdre en qualité. Sans compter qu’il permet aussi une meilleure isolation thermique et qu’il est plus facile à recycler.
Toutefois, le bâtiment le plus économe est celui qu’on ne construit pas. Les acteurs du data center doivent donc privilégier la reconversion de sites existants lorsque cela s’avère possible, grâce au rétrofit de data centers d’ancienne génération ou à la transformation de bâtiments en friche tel que l’ancienne base de sous-marins Martha du Grand Port de Marseille.
Vers une plus grande circularité des équipements
Dans un contexte de baisse de l’empreinte carbone d’un data center, il s’avère également essentiel de réduire les émissions des équipements qui le composent : équipements électriques, de refroidissement, mais également les câblages, et chemins de câbles, ces derniers représentant la part la plus importante de l’empreinte liée à ces équipements.
Ainsi, dans un data center de nouvelle génération, l’optimisation de la maintenance de ces équipements, grâce à des réseaux de capteurs, offre la possibilité de prolonger leur durée de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental. Le réemploi de ces équipements au sein d’autres installations, leur remise à niveau ou leur recyclage, dans une logique de circularité, peuvent également éviter la production de nouveaux produits et optimiser les ressources.
Toutefois, cette filière de valorisation souffre d’un manque de maturité, entravant l’innovation et l’apparition de nouvelles solutions. Ainsi, l’absence d’informations fiables sur le bilan carbone des produits complique les prises de décision éclairées. Pour avancer, il est impératif que les fabricants investissent dans des solutions plus durables, tout en fournissant des données transparentes pour orienter les décisions vers ces équipements bas-carbone.
Cette démarche exige de mesurer et planifier avec soin les processus de démantèlement, de récupération des composants et leur réintégration dans de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements. Outre les garanties sur la qualité, un cycle vertueux, de l’éco-conception au réemploi des produits mis sur le marché, doit s’engager avec les fabricants pour encadrer et développer cette démarche, et lui donner une légitimité en termes de réduction d’impacts.
Conformément aux objectifs du Scope 3, seule une approche collective permettra de réduire l’empreinte carbone des data centers et des infrastructures associées. Place désormais à l’action collective ! De la conception aux opérations, les acteurs de l’industrie des data centers doivent concentrer leurs efforts sur les domaines où ils ont un contrôle direct mais également mobiliser l’ensemble de leur chaîne de valeur en embarquant leurs fournisseurs et partenaires. Le chemin est ardu et complexe, mais absolument nécessaire au regard des enjeux de la filière.
* Source Arcep/Ademe, 2023